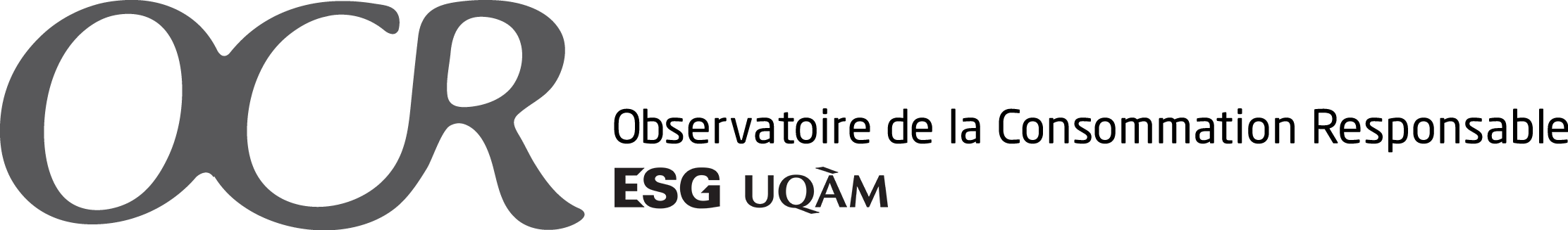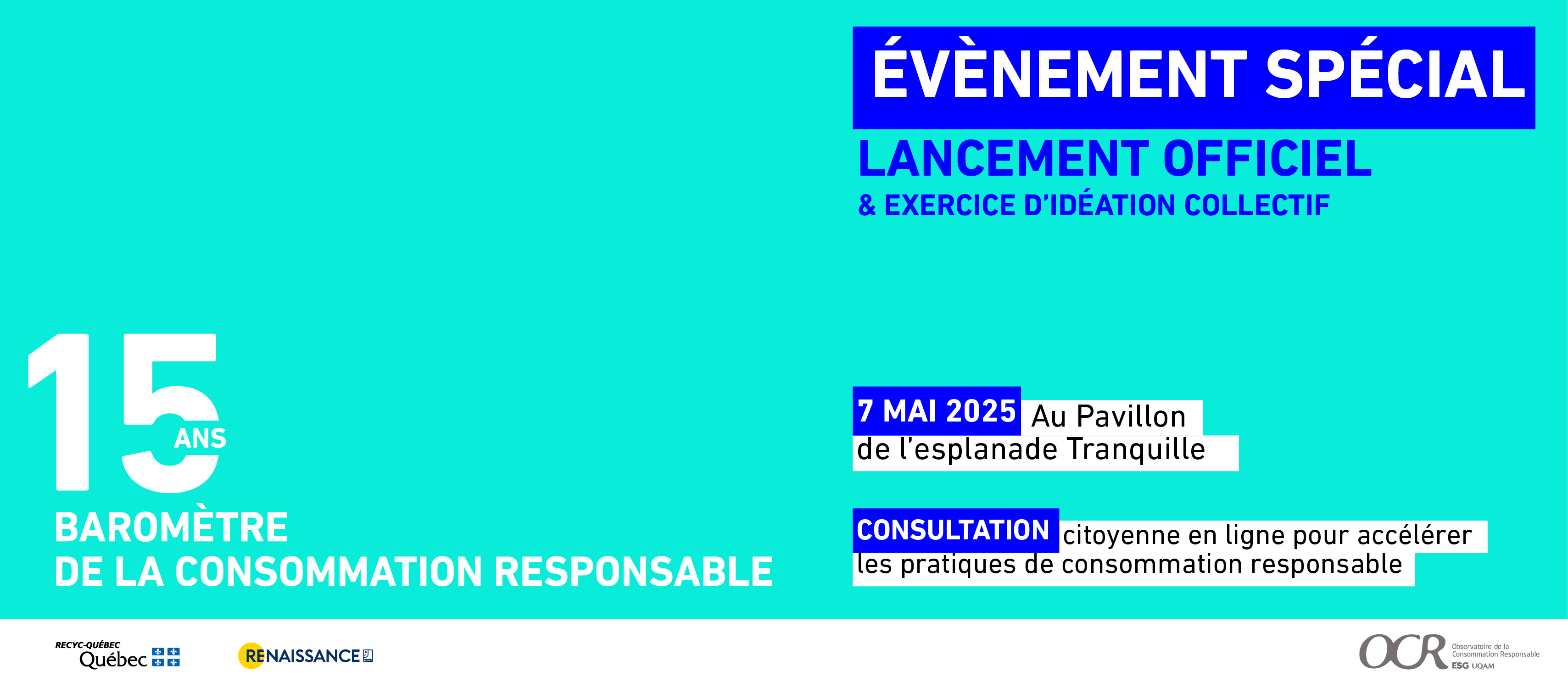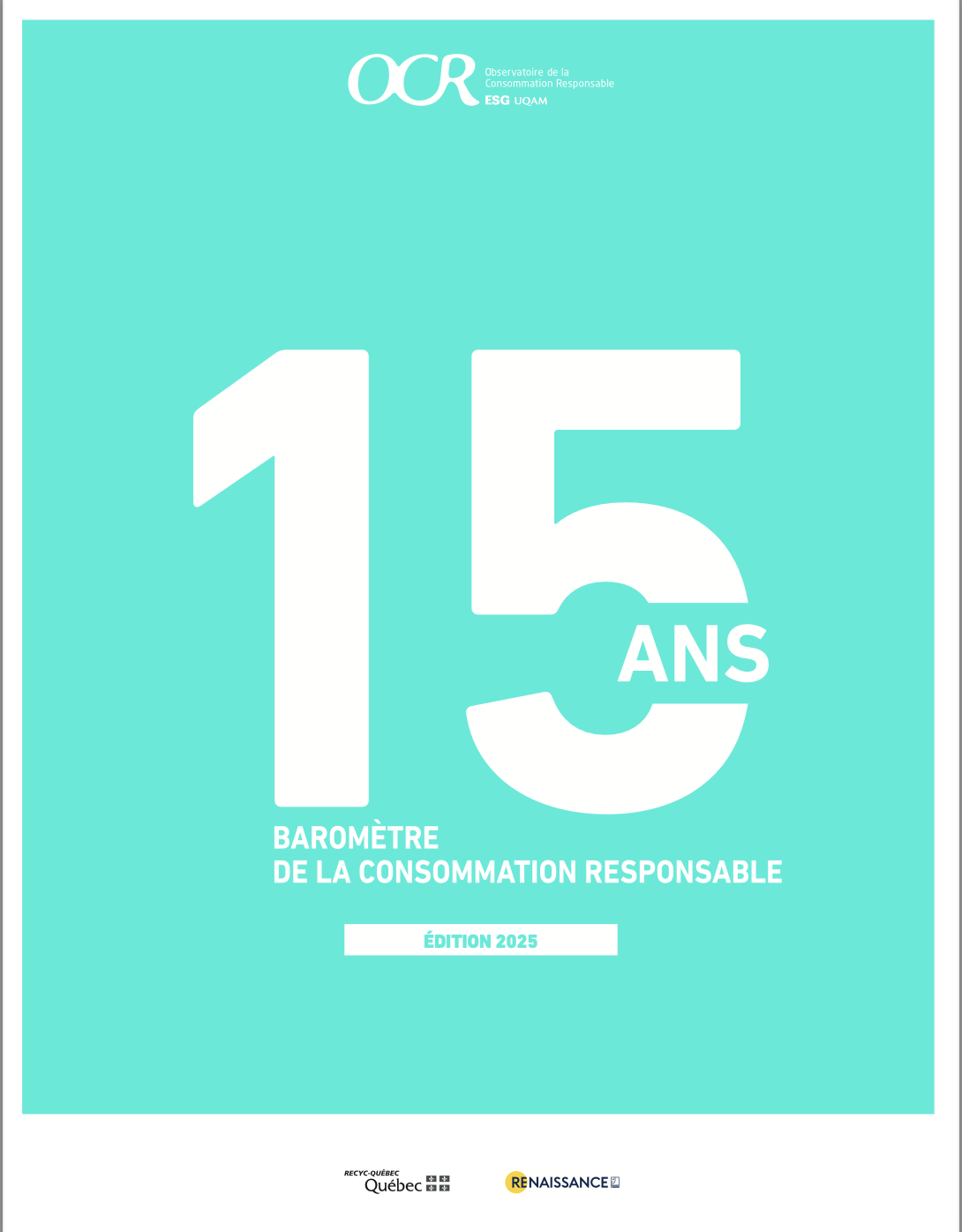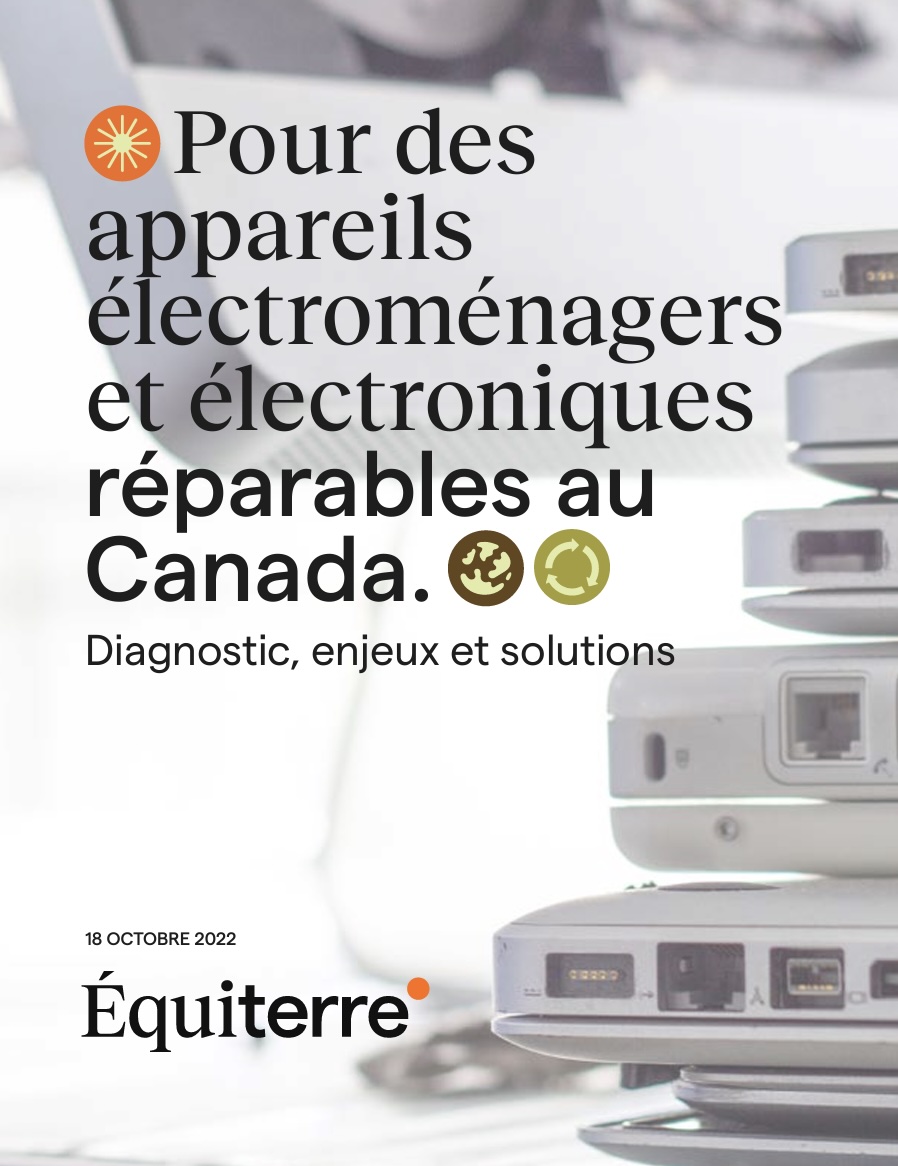Baromètre 2025 de l’Observatoire de la consommation responsable de l’ESG UQAM : 15 ans d’analyse des pratiques de consommation responsable
Montréal, 7 mai 2025 – L’édition marquant les 15 ans du Baromètre de la consommation responsable, menée par l’Observatoire de la consommation responsable (OCR) de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, dresse un bilan lucide, nuancé et révélateur des comportements des Québécoises et Québécois. Si la consommation responsable s’ancre progressivement dans les habitudes, elle reste confrontée à des tensions majeures : impact du coût de la vie, écofatigue ambiante, perte de repères collectifs et contradictions à surmonter.
Une vision élargie de la consommation responsable.
« La consommation responsable n’est plus perçue comme un simple réflexe d’achat écologique. Elle devient un mode de vie durable, enraciné dans le quotidien comme le reflètent ces résultats », souligne Fabien Durif, directeur de l’OCR et professeur au Département de marketing de l’ESG UQAM.
- Limiter le gaspillage (85,5% y associent ce comportement);
- Repenser ses besoins (80,2%);
- Privilégier la qualité et la santé (77,4%);
- Faire preuve de sobriété (74,5%);
- Et acheter local (71,9%).
Une forte adhésion, mais un engagement à nuancer.
86,7 % des Québécoises et Québécois (+ 14,6 pts vs 2019) affirment consommer de manière responsable. Pourtant, seulement 18,7 % se disent pleinement engagés. Les hommes affichent un écart entre perception et action, tandis que 64 % de la population estime consommer de manière plus responsable qu’il y a 10 ans.
Des gestes bien ancrés… d’autres à renforcer.
Le Baromètre souligne des avancées notables :
- Déconsommation (+ 2,9 pts vs 2010);
- Compostage (+ 21,6 pts);
- Protection des animaux (+ 1,5 pts);
- Achat de seconde main (+ 2,8 pts vs 2019);
- Recours aux plateformes collaboratives (+ 11,5 pts vs 2019).
À l’inverse, quelques stagnations, voire reculs, sont remarqués, expliqués par des enjeux économiques, logistiques ou psychologiques :
- Recyclage (- 0,8 pt vs 2010);
- Consommation locale (- 0,4 pt vs 2010);
- Engagement citoyen (- 2,2 pts vs 2010).
Le recyclage reste la pratique la plus courante (83,5% l’on fait fréquemment dans la dernière année), illustré dans le panier des Québécoises et des Québécois par l’achat constant de produits fabriqués à partir de matières recyclées. En parallèle, l’attrait pour les certifications alimentaires et manufacturières locales (« Bœuf du Québec », « SAQ Origine Québec », « Produits du Québec », etc.) progresse dans les achats déclarés.
Portrait citoyen de la consommation responsable : entre stabilité et mutations.
« Après 15 ans d’observation, une réalité s’impose : les femmes et les personnes aînées sont les véritables moteurs de la consommation responsable au Québec », remarque Fabien Durif. Les femmes, en particulier, se distinguent nettement par une approche globale et affirmée. Elles restent les plus engagées sur toutes les pratiques de consommation responsable, à l’exception de celles de mutualisation. Ce sont elles qui mènent actuellement les transformations vers une consommation plus sobre ».
Les personnes de plus de 65 ans privilégient des gestes concrets : aliments de saison, achats locaux et écologiques, produits recyclés ou encore réduction de leur consommation de viande, de produits transformés et d’énergie. Pragmatique et mesurée, cette génération limite également les achats impulsifs et compare systématiquement les prix. Toutefois, elle reste plus distante vis-à-vis des nouvelles pratiques collaboratives émergentes.
À l’opposé, les jeunes générations et celles et ceux vivant en ville façonnent une écologie quotidienne différente : collaborative, alternative, mais traversée de contradictions et de défis à surmonter. Les hommes, quant à eux, se montrent plus confiants qu’engagés, révélant un décalage entre discours et réalité.